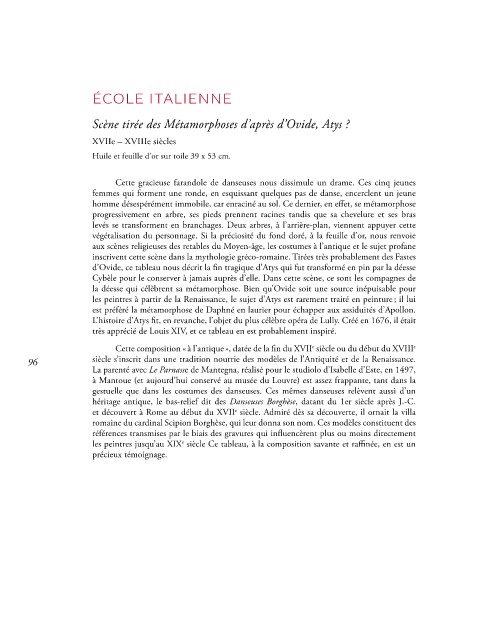Page 96 - catalogue tableaux_08-2020
P. 96
ÉCOLE ITALIENNE
Scène tirée des Métamorphoses d’après d’Ovide, Atys ?
XVIIe – XVIIIe siècles
Huile et feuille d’or sur toile 39 x 53 cm.
Cette gracieuse farandole de danseuses nous dissimule un drame. Ces cinq jeunes
femmes qui forment une ronde, en esquissant quelques pas de danse, encerclent un jeune
homme désespérément immobile, car enraciné au sol. Ce dernier, en effet, se métamorphose
progressivement en arbre, ses pieds prennent racines tandis que sa chevelure et ses bras
levés se transforment en branchages. Deux arbres, à l’arrière-plan, viennent appuyer cette
végétalisation du personnage. Si la préciosité du fond doré, à la feuille d’or, nous renvoie
aux scènes religieuses des retables du Moyen-âge, les costumes à l’antique et le sujet profane
inscrivent cette scène dans la mythologie gréco-romaine. Tirées très probablement des Fastes
d’Ovide, ce tableau nous décrit la fin tragique d’Atys qui fut transformé en pin par la déesse
Cybèle pour le conserver à jamais auprès d’elle. Dans cette scène, ce sont les compagnes de
la déesse qui célèbrent sa métamorphose. Bien qu’Ovide soit une source inépuisable pour
les peintres à partir de la Renaissance, le sujet d’Atys est rarement traité en peinture ; il lui
est préféré la métamorphose de Daphné en laurier pour échapper aux assiduités d’Apollon.
L’histoire d’Atys fit, en revanche, l’objet du plus célèbre opéra de Lully. Créé en 1676, il était
très apprécié de Louis XIV, et ce tableau en est probablement inspiré.
e
e
Cette composition « à l’antique », datée de la fin du XVII siècle ou du début du XVIII
96 siècle s’inscrit dans une tradition nourrie des modèles de l’Antiquité et de la Renaissance.
La parenté avec Le Parnasse de Mantegna, réalisé pour le studiolo d’Isabelle d’Este, en 1497,
à Mantoue (et aujourd’hui conservé au musée du Louvre) est assez frappante, tant dans la
gestuelle que dans les costumes des danseuses. Ces mêmes danseuses relèvent aussi d’un
héritage antique, le bas-relief dit des Danseuses Borghèse, datant du 1er siècle après J.-C.
e
et découvert à Rome au début du XVII siècle. Admiré dès sa découverte, il ornait la villa
romaine du cardinal Scipion Borghèse, qui leur donna son nom. Ces modèles constituent des
références transmises par le biais des gravures qui influencèrent plus ou moins directement
les peintres jusqu’au XIX siècle Ce tableau, à la composition savante et raffinée, en est un
e
précieux témoignage.