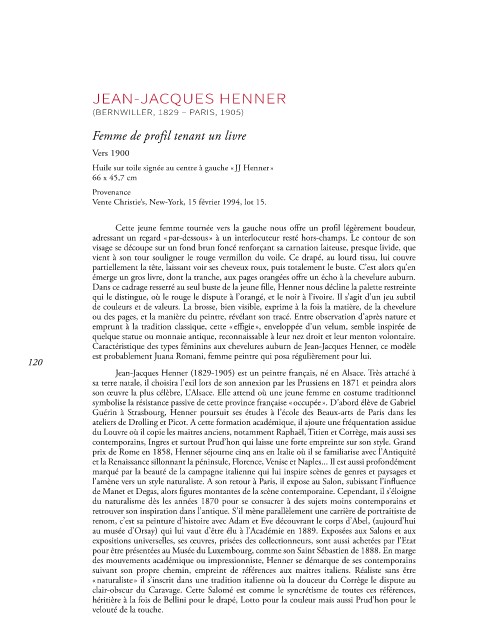Page 120 - catalogue tableaux_08-2020
P. 120
JEAN-JACQUES HENNER
(BERNWILLER, 1829 – PARIS, 1905)
Femme de profil tenant un livre
Vers 1900
Huile sur toile signée au centre à gauche « JJ Henner »
66 x 45,7 cm
Provenance
Vente Christie’s, New-York, 15 février 1994, lot 15.
Cette jeune femme tournée vers la gauche nous offre un profil légèrement boudeur,
adressant un regard « par-dessous » à un interlocuteur resté hors-champs. Le contour de son
visage se découpe sur un fond brun foncé renforçant sa carnation laiteuse, presque livide, que
vient à son tour souligner le rouge vermillon du voile. Ce drapé, au lourd tissu, lui couvre
partiellement la tête, laissant voir ses cheveux roux, puis totalement le buste. C’est alors qu’en
émerge un gros livre, dont la tranche, aux pages orangées offre un écho à la chevelure auburn.
Dans ce cadrage resserré au seul buste de la jeune fille, Henner nous décline la palette restreinte
qui le distingue, où le rouge le dispute à l’orangé, et le noir à l’ivoire. Il s’agit d’un jeu subtil
de couleurs et de valeurs. La brosse, bien visible, exprime à la fois la matière, de la chevelure
ou des pages, et la manière du peintre, révélant son tracé. Entre observation d’après nature et
emprunt à la tradition classique, cette « effigie », enveloppée d’un velum, semble inspirée de
quelque statue ou monnaie antique, reconnaissable à leur nez droit et leur menton volontaire.
Caractéristique des types féminins aux chevelures auburn de Jean-Jacques Henner, ce modèle
est probablement Juana Romani, femme peintre qui posa régulièrement pour lui.
120
Jean-Jacques Henner (1829-1905) est un peintre français, né en Alsace. Très attaché à
sa terre natale, il choisira l’exil lors de son annexion par les Prussiens en 1871 et peindra alors
son œuvre la plus célèbre, L’Alsace. Elle attend où une jeune femme en costume traditionnel
symbolise la résistance passive de cette province française « occupée ». D’abord élève de Gabriel
Guérin à Strasbourg, Henner poursuit ses études à l’école des Beaux-arts de Paris dans les
ateliers de Drolling et Picot. A cette formation académique, il ajoute une fréquentation assidue
du Louvre où il copie les maitres anciens, notamment Raphaël, Titien et Corrège, mais aussi ses
contemporains, Ingres et surtout Prud’hon qui laisse une forte empreinte sur son style. Grand
prix de Rome en 1858, Henner séjourne cinq ans en Italie où il se familiarise avec l’Antiquité
et la Renaissance sillonnant la péninsule, Florence, Venise et Naples... Il est aussi profondément
marqué par la beauté de la campagne italienne qui lui inspire scènes de genres et paysages et
l’amène vers un style naturaliste. A son retour à Paris, il expose au Salon, subissant l’influence
de Manet et Degas, alors figures montantes de la scène contemporaine. Cependant, il s’éloigne
du naturalisme dès les années 1870 pour se consacrer à des sujets moins contemporains et
retrouver son inspiration dans l’antique. S’il mène parallèlement une carrière de portraitiste de
renom, c’est sa peinture d’histoire avec Adam et Eve découvrant le corps d’Abel, (aujourd’hui
au musée d’Orsay) qui lui vaut d’être élu à l’Académie en 1889. Exposées aux Salons et aux
expositions universelles, ses œuvres, prisées des collectionneurs, sont aussi achetées par l’Etat
pour être présentées au Musée du Luxembourg, comme son Saint Sébastien de 1888. En marge
des mouvements académique ou impressionniste, Henner se démarque de ses contemporains
suivant son propre chemin, empreint de références aux maitres italiens. Réaliste sans être
« naturaliste » il s’inscrit dans une tradition italienne où la douceur du Corrège le dispute au
clair-obscur du Caravage. Cette Salomé est comme le syncrétisme de toutes ces références,
héritière à la fois de Bellini pour le drapé, Lotto pour la couleur mais aussi Prud’hon pour le
velouté de la touche.