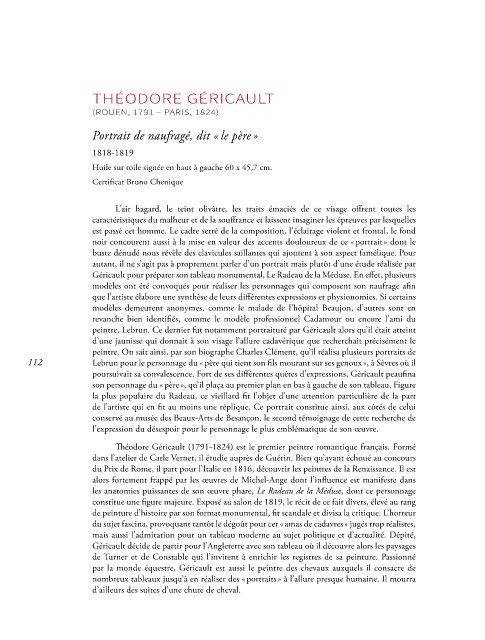Page 112 - catalogue tableaux_08-2020
P. 112
THÉODORE GÉRICAULT
(ROUEN, 1791 – PARIS, 1824)
Portrait de naufragé, dit « le père »
1818-1819
Huile sur toile signée en haut à gauche 60 x 45,7 cm.
Certificat Bruno Chenique
L’air hagard, le teint olivâtre, les traits émaciés de ce visage offrent toutes les
caractéristiques du malheur et de la souffrance et laissent imaginer les épreuves par lesquelles
est passé cet homme. Le cadre serré de la composition, l’éclairage violent et frontal, le fond
noir concourent aussi à la mise en valeur des accents douloureux de ce « portrait » dont le
buste dénudé nous révèle des clavicules saillantes qui ajoutent à son aspect famélique. Pour
autant, il ne s’agit pas à proprement parler d’un portrait mais plutôt d’une étude réalisée par
Géricault pour préparer son tableau monumental, Le Radeau de la Méduse. En effet, plusieurs
modèles ont été convoqués pour réaliser les personnages qui composent son naufrage afin
que l’artiste élabore une synthèse de leurs différentes expressions et physionomies. Si certains
modèles demeurent anonymes, comme le malade de l’hôpital Beaujon, d’autres sont en
revanche bien identifiés, comme le modèle professionnel Cadamour ou encore l’ami du
peintre, Lebrun. Ce dernier fut notamment portraituré par Géricault alors qu’il était atteint
d’une jaunisse qui donnait à son visage l’allure cadavérique que recherchait précisément le
peintre. On sait ainsi, par son biographe Charles Clément, qu’il réalisa plusieurs portraits de
112 Lebrun pour le personnage du « père qui tient son fils mourant sur ses genoux », à Sèvres où il
poursuivait sa convalescence. Fort de ses différentes quêtes d’expressions, Géricault peaufina
son personnage du « père », qu’il plaça au premier plan en bas à gauche de son tableau. Figure
la plus populaire du Radeau, ce vieillard fit l’objet d’une attention particulière de la part
de l’artiste qui en fit au moins une réplique. Ce portrait constitue ainsi, aux côtés de celui
conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon, le second témoignage de cette recherche de
l’expression du désespoir pour le personnage le plus emblématique de son œuvre.
Théodore Géricault (1791-1824) est le premier peintre romantique français. Formé
dans l’atelier de Carle Vernet, il étudie auprès de Guérin. Bien qu’ayant échoué au concours
du Prix de Rome, il part pour l’Italie en 1816, découvrir les peintres de la Renaissance. Il est
alors fortement frappé par les œuvres de Michel-Ange dont l’influence est manifeste dans
les anatomies puissantes de son œuvre phare, Le Radeau de la Méduse, dont ce personnage
constitue une figure majeure. Exposé au salon de 1819, le récit de ce fait divers, élevé au rang
de peinture d’histoire par son format monumental, fit scandale et divisa la critique. L’horreur
du sujet fascina, provoquant tantôt le dégoût pour cet « amas de cadavres » jugés trop réalistes,
mais aussi l’admiration pour un tableau moderne au sujet politique et d’actualité. Dépité,
Géricault décide de partir pour l’Angleterre avec son tableau où il découvre alors les paysages
de Turner et de Constable qui l’invitent à enrichir les registres de sa peinture. Passionné
par la monde équestre, Géricault est aussi le peintre des chevaux auxquels il consacre de
nombreux tableaux jusqu’à en réaliser des « portraits » à l’allure presque humaine. Il mourra
d’ailleurs des suites d’une chute de cheval.