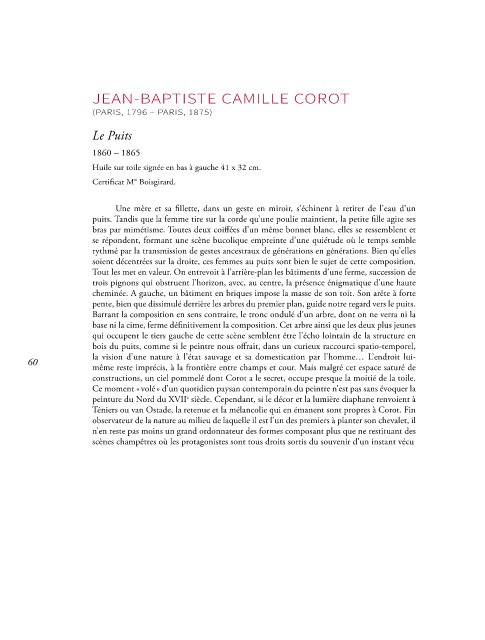Page 60 - catalogue tableaux_08-2020
P. 60
JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT
(PARIS, 1796 – PARIS, 1875)
Le Puits
1860 – 1865
Huile sur toile signée en bas à gauche 41 x 32 cm.
Certificat M° Boisgirard.
Une mère et sa fillette, dans un geste en miroir, s’échinent à retirer de l’eau d’un
puits. Tandis que la femme tire sur la corde qu’une poulie maintient, la petite fille agite ses
bras par mimétisme. Toutes deux coiffées d’un même bonnet blanc, elles se ressemblent et
se répondent, formant une scène bucolique empreinte d’une quiétude où le temps semble
rythmé par la transmission de gestes ancestraux de générations en générations. Bien qu’elles
soient décentrées sur la droite, ces femmes au puits sont bien le sujet de cette composition.
Tout les met en valeur. On entrevoit à l’arrière-plan les bâtiments d’une ferme, succession de
trois pignons qui obstruent l’horizon, avec, au centre, la présence énigmatique d’une haute
cheminée. A gauche, un bâtiment en briques impose la masse de son toit. Son arête à forte
pente, bien que dissimulé derrière les arbres du premier plan, guide notre regard vers le puits.
Barrant la composition en sens contraire, le tronc ondulé d’un arbre, dont on ne verra ni la
base ni la cime, ferme définitivement la composition. Cet arbre ainsi que les deux plus jeunes
qui occupent le tiers gauche de cette scène semblent être l’écho lointain de la structure en
bois du puits, comme si le peintre nous offrait, dans un curieux raccourci spatio-temporel,
la vision d’une nature à l’état sauvage et sa domestication par l’homme… L’endroit lui-
60
même reste imprécis, à la frontière entre champs et cour. Mais malgré cet espace saturé de
constructions, un ciel pommelé dont Corot a le secret, occupe presque la moitié de la toile.
Ce moment « volé » d’un quotidien paysan contemporain du peintre n’est pas sans évoquer la
e
peinture du Nord du XVII siècle. Cependant, si le décor et la lumière diaphane renvoient à
Téniers ou van Ostade, la retenue et la mélancolie qui en émanent sont propres à Corot. Fin
observateur de la nature au milieu de laquelle il est l’un des premiers à planter son chevalet, il
n’en reste pas moins un grand ordonnateur des formes composant plus que ne restituant des
scènes champêtres où les protagonistes sont tous droits sortis du souvenir d’un instant vécu