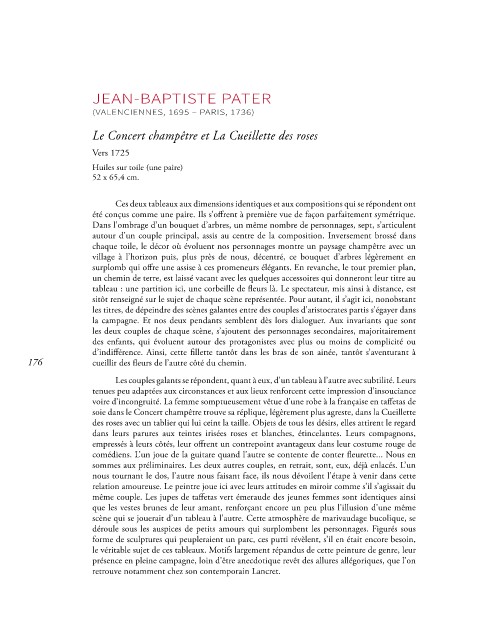Page 176 - catalogue tableaux_08-2020
P. 176
JEAN-BAPTISTE PATER
(VALENCIENNES, 1695 – PARIS, 1736)
Le Concert champêtre et La Cueillette des roses
Vers 1725
Huiles sur toile (une paire)
52 x 65,4 cm.
Ces deux tableaux aux dimensions identiques et aux compositions qui se répondent ont
été conçus comme une paire. Ils s’offrent à première vue de façon parfaitement symétrique.
Dans l’ombrage d’un bouquet d’arbres, un même nombre de personnages, sept, s’articulent
autour d’un couple principal, assis au centre de la composition. Inversement brossé dans
chaque toile, le décor où évoluent nos personnages montre un paysage champêtre avec un
village à l’horizon puis, plus près de nous, décentré, ce bouquet d’arbres légèrement en
surplomb qui offre une assise à ces promeneurs élégants. En revanche, le tout premier plan,
un chemin de terre, est laissé vacant avec les quelques accessoires qui donneront leur titre au
tableau : une partition ici, une corbeille de fleurs là. Le spectateur, mis ainsi à distance, est
sitôt renseigné sur le sujet de chaque scène représentée. Pour autant, il s’agit ici, nonobstant
les titres, de dépeindre des scènes galantes entre des couples d’aristocrates partis s’égayer dans
la campagne. Et nos deux pendants semblent dès lors dialoguer. Aux invariants que sont
les deux couples de chaque scène, s’ajoutent des personnages secondaires, majoritairement
des enfants, qui évoluent autour des protagonistes avec plus ou moins de complicité ou
d’indifférence. Ainsi, cette fillette tantôt dans les bras de son ainée, tantôt s’aventurant à
176 cueillir des fleurs de l’autre côté du chemin.
Les couples galants se répondent, quant à eux, d’un tableau à l’autre avec subtilité. Leurs
tenues peu adaptées aux circonstances et aux lieux renforcent cette impression d’insouciance
voire d’incongruité. La femme somptueusement vêtue d’une robe à la française en taffetas de
soie dans le Concert champêtre trouve sa réplique, légèrement plus agreste, dans la Cueillette
des roses avec un tablier qui lui ceint la taille. Objets de tous les désirs, elles attirent le regard
dans leurs parures aux teintes irisées roses et blanches, étincelantes. Leurs compagnons,
empressés à leurs côtés, leur offrent un contrepoint avantageux dans leur costume rouge de
comédiens. L’un joue de la guitare quand l’autre se contente de conter fleurette... Nous en
sommes aux préliminaires. Les deux autres couples, en retrait, sont, eux, déjà enlacés. L’un
nous tournant le dos, l’autre nous faisant face, ils nous dévoilent l’étape à venir dans cette
relation amoureuse. Le peintre joue ici avec leurs attitudes en miroir comme s’il s’agissait du
même couple. Les jupes de taffetas vert émeraude des jeunes femmes sont identiques ainsi
que les vestes brunes de leur amant, renforçant encore un peu plus l’illusion d’une même
scène qui se jouerait d’un tableau à l’autre. Cette atmosphère de marivaudage bucolique, se
déroule sous les auspices de petits amours qui surplombent les personnages. Figurés sous
forme de sculptures qui peupleraient un parc, ces putti révèlent, s’il en était encore besoin,
le véritable sujet de ces tableaux. Motifs largement répandus de cette peinture de genre, leur
présence en pleine campagne, loin d’être anecdotique revêt des allures allégoriques, que l’on
retrouve notamment chez son contemporain Lancret.